Bénédicte Vilgrain
Bénédicte Vilgrain est née en 1959. Elle crée le Théâtre Typographique en 1984, dans une cour d’immeuble, sur une presse à épreuves. Elle y imprime des livres à tirage limité d’assez grands formats, marqués par son intérêt pour les littératures orales d’Asie et d’Afrique, et l’anthropologie. Elle est rejointe par Bernard Rival en 1988 ; leur collaboration depuis lors a constitué la maison d’édition précieuse et exigeante que nous connaissons aujourd’hui : http://thty.fr/
Entre 1981 et 1991, Bénédicte Vilgrain étudie le tibétain dans l’espoir, explique-t-elle, « d’établir un Wortschatz, un vocabulaire où chaque mot recensé aurait été traité comme la clef d’usages diversifiés, métaphoriques, évoqués dans des proverbes. Mais la langue tibétaine est un medium aussi éloigné de la langue française qu’un rêve peut l’être de son interprétation discursive. » (Abigail Lang, « L’interprétation des raves, Lecture de Bénédicte Vilgrain », dans les Intensifs, poètes du XXI° siècle, Critique n°735 – 736, août-septembre 2008.)
Depuis 2001, Bénédicte Vilgrain a décidé de « ranger », pour que rien ne se perde, son vocabulaire dans une « Grammaire », établie sur le modèle classique de la Grammaire de Thonmi Sombhota (VII° siècle), où chaque articulation phonologique de base de la langue tibétaine fait l’objet, sous l’aspect d’une strophe en vers de sept syllabes nommée śloka, d’un développement grammatical et phonétique.
Ainsi, à propos de la sixième lettre suffixe – motif du dixième chapitre intitulé bČu, que nous publions dans la collection agrafée en 2012 – qui indique peut-être la place de ce chapitre dans l’œuvre de Bénédicte Vilgrain, ce śloka de Thonmi Sombhota :
« La sixième, censée relier ce qu’on série…
Ainsi, faisons suivre les dix lettres suffixes
de la sixième, on aura relié ce qu’on avait sérié. »
(À propos du chapitre dix et de la place centrale qu’y occupe Gendun Chöp’el (1903−1951), nous renvoyons notre lecteur au Bulletin n°13.)
Dans la même collection agrafée paraît en 2022 des objets, du poète allemand Ulf Stolterfoht, traduit par Bénédicte Vilgrain, et approprié par la traductrice de sorte que ce texte constitue le chapitre 11.2 de sa « grammaire tibétaine ». Bénédicte Vilgrain explique son geste dans une passionnante postface intitulée « Ulf Stolterfoht fête. DJane Husserl ».
-
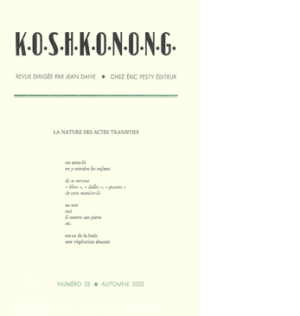
K.O.S.H.K.O.N.O.N.G. 23
11,00 €novembre 2022
15,5 x 24 cm, 20 pages
isbn : 978−2−917786−79−6 -
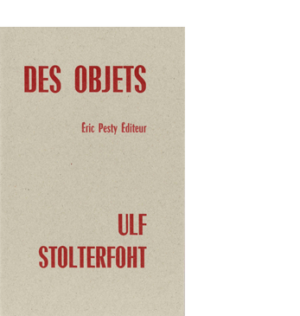
des objets
10,00 €de Ulf Stolterfoht
traduit de l’allemand et postfacé par Bénédicte Vilgrain
2022
14 x 22 cm, 16 pages
isbn : 978−2−917786−76−5 -
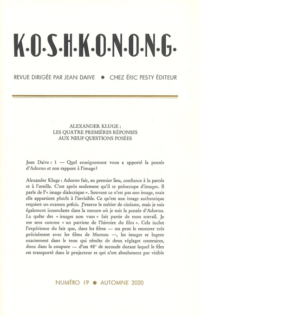
K.O.S.H.K.O.N.O.N.G. 19
11,00 €novembre 2020
15,5 x 24 cm, 24 pages
isbn : 978−2−917786−66−6 -
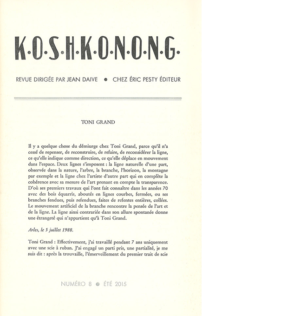
K.O.S.H.K.O.N.O.N.G. 8
11,00 €août 2015
15,5 x 24 cm, 20 pages
isbn : 978−2−917786−33−8 -
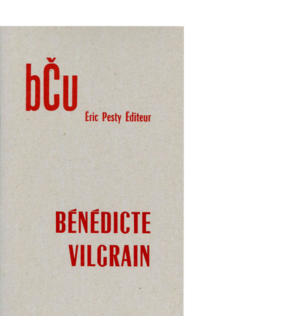
bČu « Une grammaire tibétaine », chapitre 10
9,00 €de Bénédicte Vilgrain
2012
14 x 22 cm, 36 pages
isbn : 978−2−917786−14−7
Lecture en ligne par Bénédicte Vilgrain :
Bulletin n°13 (à propos de Fachsprachen XXI, Johann Georg Hamann de Ulf Stolterfoht).
Chez d’autres éditeurs :
Dernière mise à jour 2011
« Une grammaire tibétaine »
- ka, chapitre un, contrat maint, 2001.
- sKu, chapitre deux, éditions de l’Attente, 2002.
- Khà, chapitre trois, contrat maint, 2003.
- g’i, chapitre cinq, 49 Poètes, un collectif, Flammarion 2004.
- Grog(s), chapitre six, contrat maint, 2004.
- Nga, chapitre sept, Fin n°24, 2006.
- Ngà, chapitre huit, Héros-Limite, 2009.
- gČig, chapitre neuf, contrat maint, 2011.
Parmi les traductions de B. V. :
- La Raison de l’oiseau, poèmes du Sixième Dalaï Lama, Fata Morgana, 1986 – 2012.
- Où l’on apprend que Cendrillon a tué sa mère, une version tibétaine des Contes de Vetâla, TH.TY., 1984 – 2005.
- Chapitre trois des Contes du Vetâla, dans Françoise Pommaret, Revenant de la mort, litanies des revenantes bhoutanaises, TH.TY., 1988.
- Walter Benjamin, Allemands, dix lettres parmi vingt-cinq, traduction et notes avec Monique Rival, TH.TY. 1992 – 2002.
- Goethe, Almanach de 1822 (esquisse préparatoire à l’élégie de Marienbad), avec Bernard Rival, dessins de Toru Kaneko, TH.TY., 1995.
- Vogelweide, Poème(s), traduction et typographie avec Julie Ganzin, TH.TY., 1997.
- Klaus Theweleit, Un plus un ; images, mémoire. Sur le cinéma de Godard et de Lanzmann. Avec Pierre Rusch, TH.TY., 2000.
- Paul de Man, Wilhelm von Humboldt et Barton Byg, Autour de la tâche du traducteur, traduction avec Alexis Nouss et Bernard Rival, TH.TY., 2003.
- Wilhelm von Humboldt, Sur le verbe dans les langues américaines, contrat maint, 2007.
- Oskar Pastior, 21 Poèmes-anagrammes d’après Hebel, traduction avec Frédéric Forte, TH.TY., 2008.
- Keith Waldrop, Pertes inespérées, traduction B. Rival/B.Vilgrain, TH.TY., 2008.
- Friederich A. Kittler, 1900 Mode d’emploi, recueil de textes choisis et traduits par Bénédicte Vilgrain, TH.TY., 2010.